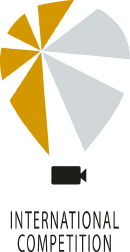ONLY AVAILABLE IN FRENCH
Distribué par Diaphana, le nouveau film de Ryûsuke Hamaguchi a remporté le prix du Scénario au Festival de Cannes 2021 et sort au cinéma ce mercredi 18 août. En 2015, son film Senses remportait la Montgolière d’argent au Festival des 3 Continents.
Joli mai !
Le mois de mai 2018 eut probablement pour Ryûsuke Hamaguchi le parfum léger d’une fête. Trois ans après sa réalisation, la sortie de Senses (2015) sur les écrans français était annoncée à l’heure précise où le cinéaste découvrait la sélection en compétition à Cannes de son nouveau film Asako I & II. Le succès critique et public en salle du premier film, malgré sa durée de cinq heures (distribué en trois parties), attisait aussitôt la curiosité pour le second sorti en France à la fin de cette même année. Comme pour d’autres avant lui (parmi lesquels Naomi Kawase au premier chef, puis Koji Fukada, Katsuya Tomita et à leur suite Tetsuya Mariko et le documentariste Kazuhiro Soda dont les films sortiront pour la première fois sur nos écrans début 2022), l’accueil réservé en France à ses films par les festivals d’abord, le public ensuite, participa à déciller un peu le regard souvent frileux de l’industrie du cinéma japonais à l’égard de jeunes auteurs dont les films ont poussé dans les marges du cinéma commercial local.
Hamaguchi sur le rivage
Quelle que soit la réalité de leur économie, les derniers films d’Hamaguchi démontre une remarquable aptitude d’adaptation à leurs contextes de production. Absorbant jusqu’à les dissoudre les signalements trop visibles de leurs écarts de moyens (casting, nombre de personnages et décors, vue aérienne, huis clos), la mise en scène d’Hamaguchi se mobilise de manière prépondérante autour des pouvoirs dévolus à la parole dans l’étendue de ses manifestations (conversations ordinaires ou intimes, enregistrements, langage des signes, lecture, répétition, théâtre, sonorités des langues…). Essentielle, renouvelée, on sait l’attention donnée par le cinéaste à cet aspect de l’écriture scénaristique, la parole en actes recouvrant moins la valeur d’une explication qu’elle ne vient creuser et donner son relief aux apparences. Les histoires en ce sens nous semblent moins racontées par un scénario dont les oscillations sont imprévisibles qu’elles ne paraissent être intensément vécues par des personnages comme soudainement arrachés à la dimension ordinaire de leur vie.
En cette année 2021, les deux nouveaux films de Ryusuke Hamaguchi Contes du hasard et autres fantaisies (Ours d’argent à la Berlinale) et Drive my car (en compétition à Cannes) livrés à quelques mois de distance donnent à voir par-delà leur communauté d’esprit deux manières limpides de considérer leurs ressources. Dans le premier, les contraintes sont estompées par le déploiement de trois histoires en forme de contes moraux. On évoquera incontournablement Rohmer ou Hong Sang-soo mais c’est l’ombre discrètement portée de Naruse qui pourrait le mieux caractériser les remous fluctuants sous un aspect de surface calme dans la manière de révéler les personnages. Il est avant toute chose admirable que ces courts récits, tendus comme des arcs dans la limite de leur durée, nous fassent presque oublier leur dimension relative de huis clos, les personnages en nombre réduit imposant ainsi la pleine intensité de leur présence. Puisqu’ils ne font que passer, nous ne les quitterons pas une seconde des yeux. Cette attention vaut autant que la formule des contes pour affaire de morale.
Adapté d’un nouvelle d’Haruki Murakami extraite d’un recueil qui en compte sept intitulé Des hommes sans femmes, Drive my car met d’abord à jour une proximité latente entre l’écrivain et le cinéaste. On aurait dû y penser plus tôt se dit-on. S’il prend des libertés avec l’œuvre de l’auteur japonais le plus lu au monde, Hamaguchi ne cherche ni à s’en affranchir ni à élever au carré le poids-mouche d’une nouvelle de cinquante de pages dans un film de trois heures. C’est plutôt l’affaire que l’un et l’autre ont en commun que le film embrasse, l’imagination de lecteur du cinéaste se saisissant d’un texte auquel il se sent intimement dialoguer. Il en va ainsi des retours à la matière même de la nouvelle dans le film, allant et venant, refluant à la manière d’un courant que la parole ramène dans le mouvement du film. Prolongeant l’adresse de son titre, le récit du Murakami joue activement son rôle de véhicule, Hamaguchi prenant en quelque sorte place aux côtés de l’écrivain, donnant l’impression de découvrir à l’état germinal dans la trajectoire romanesque de Drive my car de fertiles ambiguïtés, secrets et questions irrésolues que le film déroule à sa façon nous laissant, comme Kafuku son personnage principal, le sentiment d’être conduit sur une route au trajet inséparablement quotidien et sinueux.
Entre autres exemples remarquables de latitudes prises par le cinéaste, celui de donner au début du film vie à Oto, la femme de Kafuku (remarquable Reika Kirishima déjà actrice dans une adaptation du Norwegian Wood de Murakami par Tran Anh Hung) et d’exalter le trauma lié à sa disparition brutale. Comme pour Asako, les quatre amies de Senses, ou les victimes du tsunami dans la région de Fukushima dans les trois volets documentaires que leur consacra Hamaguchi, les circonstances impliquent un patient travail de reconstruction dont le métier de metteur en scène, ici celui de Kafuku aux prises avec Oncle Vania de Tchekhov, constitue entre réel et métaphore l’exact point d’intersection. Faire du cinéma, c’est se placer du côté du vivant, dans le cas d’Hamaguchi, du côté ceux qui ont par expérience des raisons de craindre un mauvais tour du destin et reprennent doucement pied dans leur vie en trouvant la force de donner une suite à leur histoire. Une façon de rappeler que le film ne connaît qu’un seul ordre : celui de son défilement imperturbable. Le passé peut bien faire retour, ni oubli ni jamais seulement souvenir, le film se déroule toujours au présent opposant sa palpitation à toute pétrification mortifère.
Passer le volant
Il y a ces moments où un simple petit changement de place peut avoir un effet dont la magnitude est inexplicable. Un peu forcé par le règlement du théâtre où il monte sa pièce, Kafuku cède sa place de conducteur à une jeune et impénétrable chauffeuse, Misaki. Un même trajet quotidien aller-retour répété (mais toujours filmé différement) entre le résidence temporaire du metteur en scène et le théâtre où ses acteurs s’épuisent à lire et relire chaque jour le même texte. Rien ne semble pouvoir faire dévier Kafuku qui s’attache à ses habitudes et une méthode bien mesurées pour ne pas vaciller davantage. Mais circulant désormais assis à l’arrière de sa repérable Saab 900 rouge et sa conduite à gauche, Kafuku module imperceptiblement son point de vue et celui de son écoute depuis cette voiture aux allures d’atelier mouvant où il aime (se) raconter des histoires et jadis entendre celles imaginées par sa femme. Depuis ce léger point de recul où sans passer de l’autre côté d’un miroir où il se trouverait séparée du passé par l’épaisseur d’une vitre, Kafuku va aller s’accommodant d’un ajustement de sa réalité, petite opération du merveilleux le plus ineffable, indice encore dormant d’une possible réparation et d’un recouvrement de la conscience et d’un cheminement à deux pour lui et Misaki.
Le volant que Murakami place entre les mains d’Hamaguchi semble lesté d’un même pouvoir. Drive my car pourrait être la formule magique que le cinéaste rêve de voir un jour prononcée par la plupart de ces personnages. Faisant ensemble le bout de chemin qui les sépare encore d’eux-mêmes, ils ne savent sans doute jamais qu’être deux mais désormais confiants dans leur aptitude à accueillir les incertitudes de l’autre en eux.
Les routes que tracent un film après l’autre Ryusuke Hamaguchi, échappant avec d’autres la centralité tokyoïte du cinéma japonais, sont comme de sublimes reconquêtes sur la carte d’un romanesque où inconscient et merveilleux forcent l’épreuve de l’existence.
Jérôme Baron
Plus d’infos sur le film sur le site de Diaphana.