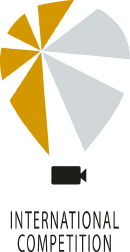Avec Henry Barakât, Kamâl ash-Shaykh, il a préparé la reconnaissance par la critique d’un cinéma égyptien d’auteur. Il est, aujourd’hui, considéré à juste titre comme le véritable maître d’œuvre d’une cinématographie sociale, imposant le réalisme. ( … ) Le seul aussi parmi ses contemporains dont l’œuvre ait acquis une envergure réelle, la seule qui ait pu, sinon s’avérer exemplaire, du moins avoir ouvert la voie à TawfÎq Sâlah comme à Ussif Châhîne. Si Barakât est demeuré trop prisonnier des limites d’un genre dans ses tentatives les plus intéressantes, Abû Sayf en a fait plusieurs fois éclater le cadre, ou a donné à l’œuvre une dimension qui l’impose encore aujourd’hui. (. .. ) Les codes des cinémas européens des années trente sévissaient toujours dans les studios du Caire, avec un refus plus net encore de tout déclassement social et de tout réalisme inconvenant. Les scènes d’amour se déroulaient selon un rituel qu’il était difficile d’enfreindre, rien n’étant autorisé que symboliquement avec malignité, Abû Sayf usa donc des symboles, musicaux ou visuels, pour introduire, sinon le réalisme, tout au moins un sentiment plus exact de la réalité. Suggérer étant parfois plus efficace que faire, le climat des films d’Abû Sayf s’affirma très vite comme différent; l’érotisme, qui ne jouait qu’un rôle théâtralisé en marge du récit lui-même dans le cinéma égyptien, par les intermèdes dansés, allait être défini cette fois en fonction de la vie quotidienne, et des rapports qu’il tisse entre les êtres. Avec des œuvres comme « Toujours dans mon cœur” (au lendemain de la deuxième guerre mondiale), ou “La Sangsue“, dix ans plus tard, une sensualité naturelle faisait irruption dans les cinémas arabes. Et une Egypte plus vraie, populaire, celle des quartiers pauvres (Boulâq, où naquit Abû Sayf, des halles, des appartements misérables … Bravant le second interdit – ce qui lui aura sans doute été moins pardonné -, l’auteur de “Contre-maître Hassan” va privilégier les personnages de Amâl Salîm (ceux de “Al-Azîma” ou de son adaptation des Misérables de Victor Hugo). Double inspiration, réaliste et littéraire, que va hériter Abû Sayf: il va donner droit de cité au petit peuple du Caire et faire de lui le plus vivant personnage de ses meilleurs films en étayant ses scénarios à la fois sur sa connaissance personnelle, vécue depuis sa jeunesse, et sur un monde romanesque dépeint par H.A. Quddus, ou Yüssif Idriss, ou bien encore et mieux inspiré par le même Caire foisonnant à l’écrivain Nagîb Mahfûz – et quand il portera à l’écran une transposition de Thérèse Raquin, d’Emile Zola, c’est avec Mahfûz qu’il en écrira le scénario (“Ton jour viendra“). Il fera une autre fois appel à l’œuvre de Zola, en adaptant “La bête humaine” sous le titre “Splendeur de l’amour“, mais sans que la photographie soignée de Wadid Sirrî domine les contraintes du maquillage de studio, sans que la mise en scène atteigne jamais , sinon au fantastique de Gance, au moins le seuil d’une démence, d’un tragique nécessaires. La littérature restait cette fois “le modèle“). Mais la même année. Abü Sayf réalisait avec “Mort parmi les vivants” un des plus étonnants mélodrames des annales cinématographiques (1960). ( … ) Contraint de ruser pour imposer aux producteurs ce langage nouveau, gestuel ou dialogué, qu’exige un cinéma aspirant aspirant à devenir le miroir d’un peuple et non plus le reflet d’u ne fantaisie, Abü Sayf ne sera jamais en mesure de radicaliser une esthétique extrêmement surveillée – même quand il devient son propre producteur (“Ton jour viendra“). Il va chaque fois reconstituer, avec une exactitude scrupuleuse, les décors et l’ambiance – tournant rarement en extérieurs -, s’efforçant d’harmoniser un statut de vedette avec un emploi d’artisan ou de femme soumise, de faire en sorte que la traduction cinématographique d’une réalité soit constamment plausible, débarrassée de ce qui n’est que décoratif ou de convention. Tout élément du cadre doit être justifié, et ces signes que les objets, les affiches, le détail du costume inscrivent parallèlement aux dialogues et à l’action composent une trame complémentaire, réaliste (“La seconde épouse“), sensualiste (“La sangsue“), historique (“Le ‘Caire 30“), dont le symbolisme entraîne parfois de la part de la caméra une insistance qu’un spectateur occidental peut juger par trop perceptible. Encore faut-il ne pas omettre l’importance primordiale du dialogue dans les Cinémas arabes – importance qui ne sera remise en cause que par la naissance d’un cinéma algérien dépouillé. Sachant son public moins sensibilisé à l’image qu’au verbe, Abû Sayf a constamment travaillé à l’équilibrage de ces données apparemment contradictoires. Et s’il a toujours apporté un soin particulier à traduire dans les mots l’évolution de ses personnages, comme à intégrer les chansons dans le récit, alors qu’elles n’étaient presque toujours plaquées que pour mettre une vedette en valeur -ou les danses -, il rompt avec la tradition de la mise en images pour atteindre une véritable écriture cinématographique. Chaque composante est étudiée: bande sonore. cadrage, lumière et montage révèlent, dans les meilleurs films d’Abû Sayf et souvent dans les moins intéressants, car à partir de 1954 (“Le monstre“), tous ses films sont soigneusement construits -, non seulement un métier accompli mais un style. Il reconstitue, comme Carné avec “Le jour se lève” ou “Porte des Lilas”, inventant le faux plus vrai que le vrai, les rues du Caire, les halles (“Le costaud“), un appartement pauvre. Les ambiances sont recrées avec une sensibilité très proche du réalisme poétique français, qu’il a pu découvrir en 1939, beaucoup plus que du néo-réalisme italien dont sa rigueur l’éloigne. Mais il ne donne pas dans le populisme de l’école française. tMort parmi les vivants n’est pas une approche romantique du réel, mais la mise à nue d’une société malade de misère, aussi coupable dans l’abnégation que dans le cynisme, ce qui ressortit fondamentalement il la nature du mélodrame. ( … ) Il a notamment mis en lumière le statut de la femme dans la société égyptienne, revenant à plusieurs reprises sur l’inhumanité des coutumes liées à la virginité, au respect de la fidélité, traditions à sens unique, le bon plaisir étant dévolu à l’homme, maître et seigneur, mais facilement justicier des filles de sa famille si elles s’écartent du chemin de l’honneur: “La seconde épouse“, ou “C’est ça l’amour” ou “Les bains de Malatili” dénoncent une sujétion dont on ne peut pas assurer qu’elle ait disparu, surtout dans les classes paysannes. Mais le rôle joué par la femme dans l’œuvre d’Abu Sayf est plus complexe: dans “La sangsue“, ou “Le costaud” (plus encore qu’avec “Je suis libre“), la différence de classe sociale est utilisée comme pouvoir, l’argent peut inverser les rapports. L’argent -lié au pouvoir -, moteur du petit monde des halles gouverné par des commanditaires sans scrupules, assassins à l’occasion, ou des personnages du “Caire ’30” : le Chef de cabinet vous prendra si vous lui abandonnez la moitié de vos appointements pendant un an … Et quand le jeune solliciteur erre comme une âme en peine pendant la fête des riches, qui est la fête de “bienfaisance“, ses réflexions nous parviennent en aparté: tous pourris, tous des salauds, et pendant ce temps-là ma mère pétrit son pain … Les jeunes cinéastes lui doivent d’avoir frayé une voie difficile, élargie par Châhine, radicalisée par Tawfîq Sâlah. Une œuvre empreinte de libéralisme, qui apparaîtra timorée à qui ne la replacera pas dans son contexte historique; mais aussi chaleureuse, emplie d’humour (“Le procès 68″), et dont la dernière image du “Caire’ 30“, l’envol des tracts sur la foule massée près de Al-Azhar, mérite quand même de demeurer le symbole.
Claude Michel CUNY
Exttraits du Dictionnaire des nouveaux cinémas arabes, avec l’aimable autorisation de l’auteur et les éditions Sindbad