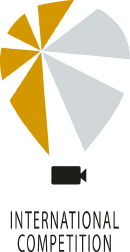A l’heure où le mélodrame semble revenir à la surface sous des formes nouvelles, il est bon de revoir les “vrais” mélos, ceux dont la violence n’était pas exhibée mais intériorisée, ceux des désirs inassouvis, des destins impossibles des femmes émérites, des garces inavouées et pourquoi pas ceux des larmes essuyées non seulement à l’écran mais aussi dans la salle.
L’Argentine des passions exacerbées, l’Argentine du tango s’est pleinement retrouvée de 1937 à 1962, dans le mélodrame cinématographique mettant en valeur de grands cinéastes, Amadori, Tinayre, Saslavsky, Demare, del Carril etc… et surtout Carlos Hugo Christensen auquel un hommage est rendu, avec pour la première fois l’intégrale des mélos qu’il a réalisés en Argentine entre 1943 et 1955.
Philippe JALLADEAU
Édito par Silvia Oroz
Le mélodrame se situe en général, dans un contexte sentimental, et comme les sentiments et l’affectivité sont toujours apparentés à ce qui est commun, le mélodrame fut donc totalement discrédité par la “haute culture”. Tout au long de ses innombrables mutations historiques, le mélodrame s’est toujours inspiré des sentiments et des drames individuels : ces deux concepts sont à la base de la communication avec le public.
Le spectateur, qui n’a pas sa place dans la vie publique, se trouve dans un espace connu et privilégié, étant donné que le mélodrame prend la vie réelle comme toile de fond.
C’est à cause de cette popularité que le genre mélodramatique fut méprisé. Touchant un public très large et hétérogène, le mélodrame se base sur des conflits simples oscillant entre le bien et le mal.
Le mot “mélodrame”, peut être vu comme un monstre à deux têtes. Mais cette vision se modifie lorsqu’on considère que l’affectivité est aussi une forme culturelle. C’est dans ce cheminement de pensée que le mélodrame apparaît comme un modèle de représentation, qui fonctionne à la façon des processus historiques et culturels, comme une toile d’araignée.
Lorsqu’apparaît le cinéma parlant en Amérique latine, on assiste, avec l’utilisation des stéréotypes et de la musique populaire, à la mise en place immédiate d’un système de références auquel le public, en grande partie analphabète ou semi-analphabète, s’identifie totalement. Les immigrants ruraux, témoins des prémices de l’urbanisation, voient dans le mélodrame, un moyen de comprendre le monde moderne. En ce sens, le mélodrame cinématographique fut l’école sentimentale de plusieurs générations.
“…Tu serais si bien ici, à aider ton père. Pourquoi aller à Buenos Aires, si loin…” dit une mère à son fils, avant qu’il ne parte pour la capitale dans Safo, histoire d’une passion. On trouve ici, de façon très explicite, une des clefs de l’histoire argentine : l’exode rural.
“…Attaché au souvenir, je continue de l’attendre…” chante Tita Merela dans La Fuite. L’attente est présentée comme étant une vertu féminine par excellence, et ce, pendant les premières décennies du cinéma parlant. Si on transpose cette vertu au mélodrame argentin, l’action se situera dans un cabaret portuaire avec le tango en musique de fond. A la fin de Chèvrefeuille, Libertad Lamarque chante, en gros plan, l’Ave Maria de Schubert. Autour de sa tête, les fleurs blanches lui donnent un air de vierge souffrante.
La dévouée Blanca – prénom lié à la chasteté – chante alors que sa soeur se marie avec l’homme qu’elle aime. La résignation, comme image de l’amour, est une autre vertu féminine : cette scène en est l’illustration parfaite.
Dans “L’hermine noire”, Laura Hidalgo descend le grand escalier de sa demeure, dans un plan d’ensemble. Elle donne des ordres à ses domestiques tout en médisant sur les invités de la soirée précédente. Le “statut social” de cette femme imposante qui descend le grand escalier de son formidable “living” est immédiatement reconnu par le public, qui a rapidement pris connaissance des codes établis dans et par le mélodrame.
On peut remarquer que le mélodrame réunit les espaces divisés par la culture. Ainsi, le mélodrame argentin des années 30, 40 et 50 fait figure d’allégorie nationale. Par ailleurs, il contribua à élaborer une image qui, pour le spectateur, fait référence à son propre univers familial : ses “idoles” parlent, s’expriment comme lui et ont les mêmes préoccupations que lui. C’est dans cette perspective que l’on peut considérer que le mélodrame est une métaphore de l’histoire nationale ; les 30 premières années du cinéma parlant argentin illustrent bien cette idée.
Silvia OROZ
Sur quelques films rescapés de l’oubli par Edgardo Cozarinsky
Jamais aussi délirant ou saugrenu que le mélodrame mexicain, un mélo argentin a bel et bien existé, dans un temps antérieur au cinéma d’auteur. Epousant selon les moments les aléas d’une production sauvage, d’abord, et ensuite ceux d’une industrie protégée et contrôlée par l’Etat, le genre devait s’éteindre, plutôt sous l’emprise de la télévision que par l’effet des secousses politiques et économiques des cinquante dernières années de l’Histoire du pays.
Besos brujos présente Libertad Lamarque au milieu des années 30, vedette de la chan- son dans sa première fraîcheur, avant que Atelio Mentasti, le puissant et visionnaire patron de l’Argentina Sono film, engage Luis Saslavsky, à l’époque jeune réalisateur aux ambitions artistiques, pour lui façonner des mélos plus stylisés, dont Puerta cerrada. Devenue la vedette la plus populaire de toute l’Amérique latine, Libertad choisit de s’exiler pendant le premier péronisme pour affirmer une carrière continentale à partir du Mexique.
Carlos Hugo Christensen, à ses débuts le plus jeune réalisateur du cinéma argentin, aussi rapide qu’irrégulier, laissa vite transparaître une sensibilité particulière. Ses films les plus personnels sont hantés par des femmes mûres éprises de jeunes hommes (Safo, El canto del cisne ) où des femmes jeunes et dévorantes menant à la mort leurs victimes (Los pulpos). Avant de se fixer au Brésil au milieu des années 50, il avait confectionné sur mesure pour la statuesque Laura Hidalgo les deux derniers vrais mélos du cinéma argentin : Armino negro et Maria Magdalena, où la vedette souffrait et faisait souffrir sur un fond de paysages exotiques, péruviens dans le premier film, brésiliens dans le second.
En 1950, Laura Hidalgo avait été dressée par le même Mentasti pour détrôner Zully Moreno, l’épouse de Luis César Amadori. Cette vedette, ce réalisateur, bien que déjà consacrés, devinrent le couple fort du premier péronisme et firent la loi dans l’Argentina Sono Film. Ils avaient pour cela un atout imparable : le succès hors toute mesure de Dios se lo pague, dont la fable populiste et le glacé très Cinecitta en ont fait le film le plus représentatif de l’époque. Profitant de leur influence, mais las de leurs caprices, demanda à Ernesto Arancibia d’essayer d’imposer avec La Orquidea une presque débutante qui pourrait concurrencer la Moreno. La vérité est que les deux actrices se sont partagées un terrain. Douées toutes les deux pour leur inexpression, Hidalgo apporta une certaine sensualité trouble, là où la Moreno s’installait dans sa beauté placide.
Très tard, Daniel Tynaire devait faire un film curieux : Bajo un mismo rostro où une Mecha Ortiz vieillissante, loin de Safo, trouve un certain élan rhétorique pour animer où une une intrigue de Guy des Cars. Tinayre avait réussi, plus tôt, de réjouissants exercices de style, dont La vendedora de fantasias reste le point le plus haut d’une carrière qui devait sombrer dans des productions de plus en plus coûteuses, le confirmant comme l’émule transatlantique des deux Henri, Decoin et Verneuil. Quant à Mecha, à la fin de carrière elle retrouva sa flamme sous la direction de Torre Nilsson, dans Boquitos pintadas et Piedra libre, deux films qu’on pourrait considérer comme la seule possible descendance des vieux mélos argentins.
Hidalgo devait trouver son meilleur rôle dans l’un des films les plus insolites de l’industrie : Mas alla del olvido. Séduit par le constat social, animé souvent par un élan revendicateur, l’ancien chanteur de tangos devenu acteur, Hugo del Carril fit une carrière de réalisateur à part dans le cinéma argentin de son époque. Ce film est unique dans sa filmographie. Adapté de Bruges la morte de Georges Rodenbach, il accumule les poncifs du mélo en costumes dans des décors poussiéreux. Produit en 1955, c’était un film déca- lé à son origine. Le grand écrivain cubain Guillermo Cabrera Infante y voit non seulement une préfiguration de Vertigo mais reconnaît son caractère de culture de série, fleurie dans une atmosphère étanche, asphyxiante.
Enfant, je n’ai pas vu ces films, souvent “interdits aux mineurs”. Jeune étudiant, je les méprisais, les yeux rivés sur les horizons lointains du cinéma d’auteur international. Maintenant je peux les regarder sans nostalgie aucune. Ils sont nouveaux pour moi. Ils me découvrent l’imaginaire, les désirs inavoués. Le contrejour du pays où je suis né, où j’ai grandi, abec cette force que seul le cinéma industriel avait : celle de percer; avec les conventions elles-mêmes pour instrument; les profondeurs non-dites de la société.
Edgardo COZARINSKY
Réalisateur
Paris, novembre 1996