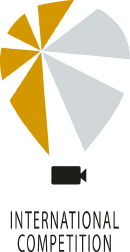Faire la reconnaissance de Glauber Rocha
par Sylvie Pierre
Ceux qui connaissaient déjà Glauber Rocha vont certainement être heureux qu’on le leur représente, à Nantes, en cette fin novembre 2000.
Car s’il fut un cinéaste des trois continents, ce fut bien Glauber. Pour lui l’axe tricontinental du cinéma était essentiel. En hommage à son ami Luis Buñuel, il appelait même cela l’Aurore que de libérer, par exemple avec Godard ou avec Pasolini, avec Solanas ou avec Straub, entre autres, le cinéma de sa tutelle hollywoodo-moskfilmo-cinecittienne commerciale et académique.
C’est même avec cette histoire de tricontinentalité que j’ai fait la connaissance de Glauber. J’étais jeune rédactrice débutante aux Cahiers du Cinéma à l’époque. Je connaissais déjà deux films de Glauber Rocha qui m’avaient passablement allumée, au niveau de ma cinéphilie veux-je dire, Le Dieu noir et le Diable Blond, que j’avais dû découvrir en 1965, et Terre en Transe, en 1967.
Cette année là Glauber Rocha fit envoyer aux Cahiers par l’ami regretté Louis Marcorelles, critique de cinéma au Monde, un texte écrit directement en français et qui s’appelait « Tricontinental/Cela s’appelle l’Aurore ». Je me proposai spontanément pour le rewriter légèrement, et à cette condition seulement, le texte fut publié, dans le numéro 195, de novembre 1967. Quelle drôle de réflexe protecteur de ce texte j’avais eu là : sans moi je savais qu’il ne passerait pas, or je tenais essentiellement à ce qu’il passe. Même si mes amis de la rédaction avaient découvert bien avant moi la beauté du cinéma de Glauber, ils ne plaisantaient pas avec le châtié de la prose. Et d’ailleurs ils avaient bien raison.
Je « réécrivis » donc Glauber Rocha en français, j’eus ce culot ingénu, avant même de le connaître, et le plus étrange est que l’intéressé ne m’en tint pas rigueur, bien au contraire. Sans doute avait-il compris lui aussi, bien avant de me connaître, qu’il pourrait avoir en moi une alliée, que ses perspectives d’aurore m’avaient déjà convaincue.
Toujours est-il qu’un beau jour de fin 1967, vraisemblablement en novembre, Glauber Rocha apparut en chair et en os dans la salle de rédaction des Cahiers qui se trouvait à l’époque dans une rue adjacente des Champs Elysées, rue Marbœuf.
Il entra dans la pièce, me salua par mon nom alors qu’il me voyait pour la première fois, et me serrant sur son cœur il m’embrassa en me remerciant pour avoir, me dit il, bien «orné» son texte.
En un éclair je vis, moi, en ce premier citoyen brésilien que je rencontrais de ma vie, le Brésil tout entier, le génie de la race, sa sauvagerie civilisée, et sa force civilisatrice.
Ceux qui ne connaissent pas encore Glauber Rocha, et ne le connaîtront qu’en découvrant ses films, s’ils n’ont pas eu comme moi et quelques autres personnes présentes en ce Festival des 3 Continents 2000 la chance de connaître en chair et en os un être humain et un esprit de cette dimension, je leur souhaite de bien faire connaissance, lors des projections nantaises, de l’artiste et de sa terre natale qu’il chante avec tant de lyrisme : ils valent la peine d’être rencontrés. Glauber Rocha est d’abord un raffiné. Ses maîtres de cinéma ont été Rossellini, Orson Welles, Visconti, Buñuel, Antonioni, et aussi (mais plus tard) Pasolini et Godard.
L’art pour l’art, la passion de l’art, l’avant-garde, la modernité, ont toujours été sa tentation. Glauber Rocha déteste le militantisme bondieuzard, la fiction de gauche aux formes académiques. En se politisant dès son premier long métrage, Barravento, en 1962, le cinéma de Glauber devient militant quelque peu cubano-marxiste, mais pour autant il garde ses gants de grand seigneur de la forme pour filmer la mer de Bahia, ses pêcheurs et sa déesse Yemanjá mulâtre.
Puis les paysages de la terre de soleil où s’affrontent Dieu et Diable entrent en transe, ses figures d’humanité deviennent des emblèmes, des types de la géopolitique et géohistoire du Brésil : sertão du Nordeste/cangaceiro, propriétaire terrien/tueur à gage et curé, monde rural, vachers/mysticisme, et la ville comme pouvoir, fascisme, démagogie, dictature, impérialisme, amour, suicide et résurrection dans la poésie. Reste que le cinéma de Glauber une fois politisé, jamais il ne se désengagera de ses compromis avec son peuple et avec son temps.
Filmant au Congo, en Espagne, à Cuba, en Italie pendant la première moitié des années soixante-dix, Glauber Rocha ne cesse de rechercher les sources de l’imaginaire de son propre continent. Der Leone has sept cabeças parle euro-polyglotte, petit nègre, et yoruba : comme ce qui a colonisé et a été colonisé au Brésil.
Les Cabeças cortadas sont les têtes coupées de cangaceiros martyrs, peut-être, ou bien celles qu’il faut encore couper pour que la révolution, à la surréaliste, soit permanente. Cet imaginaire là est celui du continent de Glauber, dont l’amitié pour Buñuel se fonde sur un rêve d’âge d’or que partagent les deux cinéastes, rêve de Mexique aussi, pré et post-colombien.
Ecrite et montée à Cuba puis en Italie, cette drôle d’Histoire du Brésil qu’a concoctée Glauber est celle d’une colonisation décolonisation permanente : ses images sont des images de cinéma, empruntées à des films de fiction brésiliens, rendus pour l’occasion à leur mission documentaire des réalités du Brésil.
Et Claro, certes, est tout sauf clair : après cinq ans d’exil hors de son pays Rocha commence franchement à péter les plombs. Plus personne en son propre pays ne voit ses films. Des imbéciles le prennent pour un opportuniste parce qu’il salue les chances d’ouverture du gouvernement militaire avec l’arrivée au pouvoir du Général Geisel. Et qui plus est, compagnon de Juliet Berto en ces années, le voilà mari brésilien en Italie d’une française actrice de Godard et un peu chinoise : pas simple !
Mais son affection réelle pour l’Italie font se réfugier ses rêves d’opprimé tropical dans le sein de Mamma Roma, pour donner un film délire, sorte d’opéra fou aux grands airs, auquel il est conseillé de se laisser aller car « the exercise will be beneficial ! »
Enfin ce pauvre Glauber revient d’exil en 1976, et qu’est-ce qu’il tourne, avant de mourir à quarante deux ans, en 1981 : deux films seulement, un très long court-métrage, Di, et un très long métrage, L’Age de la terre. Deux films maudits, chaotiques, qui saisissent comme des cauchemars, mais dont l’étoffe de rêve est d’une suprême élégance.
Di est un chant d’amour à l’artiste brésilien, un drôle de film érotique qui pousse l’approbation de la vie jusque dans la mort.
Et L’Age de la terre, si l’on en croyait l’histoire officielle du Brésil et du Portugal serait de cinq cents ans, daté de l’année même où elle fut « découverte » par le portugais Pedro Alvares Cabrai, 1500. Or Glauber Rocha, bien entendu, n’a jamais été historien officiel : pour lui la terre du Brésil existait déjà par son humanité «indienne», avant qu’elle ne fut considérée comme une Inde par des colons qui en avaient après ses réserves de poivre et d’or. Et pour lui tous les sangs qui se sont mêlés à celui du colon, – l’incroyable rencontre génétique de l’indien, de l’européen et du nègre font de tout sujet d’espèce humaine au Brésil une sorte de Christ au sang mêlé. Au fond Glauber Rocha voulait reprendre ses droits d’auteur à Pier Paolo Pasolini : il avait salué son Evangile selon Saint Mathieu de 1964 (l’année du coup d’état militaire qui installa vingt ans de dictature au Brésil), lui reconnaissant le mérite d’avoir inventé un « Christ du Tiers Monde », tellement homme qu’il blasphémait salubrement contre tous les idéalismes réactionnaires.
Mais après la mort de Pasolini en 1975, son frère, son double et même un peu son père, Glauber se sentit probablement tellement retourné qu’il lui fallut inventer son propre Christ, un peu syncrétisé avec Shangô, dieu mâle africain de la foudre. Comme en un «sauve qui peut, la mort» il s’immolerait d’ailleurs (on comprit si mal son message à l’époque), comme son grand frère italien. Mais au moins ce serait, lui, pour inventer un vrai Christ du Tiers Monde : un qui le sauverait en le rendant premier à lui-même, au moins en tant que charbonnier maître de sa foi.
C’est à dire reprenant les rênes, au travers de chevauchées fantastiques dans le rêve sud-américain, de sa propre diligence imaginaire.