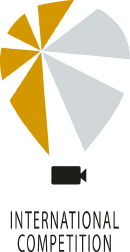À chaque pays de cinéphilie sen cinéaste consacré : au cours des années 1960 et 1970, lors de la découverte de ses films en France, Nagisa Oshima fut qualifié par certains critiques de « Godard nippon ». Formule certes commode, légitime cependant pour de nombreuses raisons : le passage préalable par l’exercice de la critique, le perpétuel travail de réflexivité du cinéaste, sa dépense acharnée de la notion de cinéma d’auteur, sa conception d’une expression artistique nécessairement politique, et le statut symbolique de leader de la Nouvelle Vague japonaise, quasi-synchrone de son homologue française. Entré à la Shochiku à la fin des années 1950, Oshima y apprend son métier, tout en développant un rejet terme du cinéma classique (Ozu, Mizoguchi, Naruse, Kurosawa, Kinoshita, etc.) et des méthodes de travail internes aux grandes compagnies productrices. Dès ses premiers films, qui évoquent les aspirations d’une jeunesse d’après- guerre révoltée et hédoniste (Contes cruels de la jeunesse) ou des laissés-pour-compte des grandes métropoles (Une ville d’amour et d’espoir, L’enterrement du soleil), il s’échappe des conventions esthétiques en vigueur, amorçant ainsi l’entrée du cinéma japonais dans la modernité. Simultanément, d’autres cinéastes (Imamura, Hani, Teshigahara, Yoshida, Shinoda, etc.) instaurent une écriture foncièrement novatrice et se détachent des rigidités narratives inspirées du cinéma américain. Le(s) Festival des 3 Continents s’est à plusieurs reprises fait l’écho de ce mouvement rétrospectivement nommé Nouvelle vague (voire artificiellement, car agglomérant des ambitions, démarches et inspirations relativement diverses), notamment lors de sa 19ème édition, en 1997.
En 1960, le retrait prématuré des écrans de Nuit et brouillard au Japon radicalise la démarche d’Oshima, qui quitte avec fracas la Shochiku pour fonder sa propre compagnie indépendante, la Sozosha, à laquelle il se consacre pleinement après avoir accepté de réaliser quelques films de commande (Le piège, pour Palace Film, en 1961, et Le révolté, l’année suivante, pour la Toei). Dès lors, presque totalement libre, il entame une phase d’intense créativité, qui durera jusqu’au début des années 1970. Au cours de cette décennie, qui reste la période la plus fascinante de son œuvre, Oshima est animé par la certitude que le renouvellement permanent («la négation de soi » selon le cinéaste) est condition vitale de la pertinence artistique, de l’appropriation politique du réel, et que la forme d’un film n’est que le véhicule du fond. Il met ainsi en scène une série de fictions dont l’esthétique et la construction narrative sont systématiquement réinventées, et ce jusque dans des variations formelles extrêmes. Conformément au principe de subjectivité-active par lequel il est guidé (la prédominance du regard subjectif de l’artiste, en dépit de toutes les contraintes, et comme fondation d’une possible discussion entre auteur et spectateurs), Oshima tente même des expériences singulières, comme avec Le journal de Yunbogi, assemblage de photos d’enfants des rues coréens et d’extraits du livre éponyme, ou encore Carnet des ninjas, adaptation d’un manga dont toutes les vignettes sont filmées, puis soumises à un montage qui en recrée la dynamique narrative.
Les films de cette période portent par ailleurs la trace de L’obsession d’Oshima pour le crime et les criminels. Le meurtre, le viol, le vol, le chantage et le mensonge sont ainsi des éléments récurrents (Les plaisirs de la chair, L’obsédé en plein jour, Été japonais : double suicide, Journal d’un voleur de Shinjuku, Le petit garçon). Et dans ses écrits, Oshima compare le statut de cinéaste à celui de hors-la-loi : même défiance envers l’ordre, mêmes prises de risque et incertitude du lendemain. Mais le véritable meurtre est celui que commet Oshima lui-même, assassinant avec préméditation le cinéma de ses pères et ses standards thématiques, qu’il enterre en évoquant sans relâche un tabou : l’expression du désir. Les manifestations protéiformes de celui-ci (comme motivation ou accomplissement, comme frustration ou obsession) sont articulées à la situation politique du Japon d’après-guerre : l’aliénation de la jeunesse, l’échec de l’extrême-gauche (Il est mort après la guerre), les conséquences de l’occupation américaine. Parallèlement, Oshima réalise de nombreux documentaires pour la télévision, notamment consacrés à l’héritage de la colonisation de la Corée et à la situation des immigrés coréens au Japon. Cette préoccupation trouve une résonance dans trois de ses fictions : À propos des chansons paillardes au Japon, Le retour des trois saoûlards, et surtout La pendaison, chef d’œuvre de parabole kafkaïenne, manifeste contre l’absurdité de la peine de mort. En 1972, Oshima réalise l’un de ses films essentiels, La cérémonie, qui met en perspective 25 ans de l’histoire du Japon avec celle des rituels d’une famille. Au milieu des années 1970, après avoir réalisé Une petite sœur pour l’été, Oshima dissout la Sozosha et aborde l’écriture d’un projet dont il estime que la représentation de la sexualité doit constituer l’intérêt premier. Sa rencontre avec le producteur français Anatole Dauman, vétéran de la Nouvelle vague française, rend cette perspective possible. En 1976, L’empire des sens, adapté d’un fait divers authentique, devient ainsi le film le plus scandaleux du monde, et l’un des plus commentés, quelques années après Le dernier tango à Paris de Bertolucci, et ce pour une raison simple : des actes sexuels non simulés y sont donnés à voir sans équivoque. Pour Oshima, le film est l’expression de la radicalité d’amour jusque dans ses outrances meurtrières, l’aboutissement d’une transgression méthodique, mais aussi, pour la première fois, synonyme de consécration internationale. Monté à Paris dans le plus grand secret, puis censuré au Japon, L’empire des sens n’y a été diffusé dans sa version intégrale qu’e normes ou ambiguës. Furyo (Merry Christmas Mister Lawrence), réalisé en 1982, met face à face deux beautés androgynes dont il capte la fascination réciproque, David Bowie et Ryuichi Sakamoto, également compositeur de la légendaire partition originale. Furyo constitue également la première apparition de Takeshi Kitano au cinéma, qui tiendra le rôle principal de Tabou (1999), jidaï-geki (film historique) décrivant le désir homosexuel généré par l’irruption d’un jeune éphèbe dans un clan de samouraïs. Et entre ces deux films, Max mon amour (1986), scénarisé parJean-Claude Carrière, évoque la relation amoureuse entre Margaret (Charlotte Rampling) et un chimpanzé, non sans s’attacher à une mise à mal de la bienséance bourgeoise, chère à Marco Ferreri.
Victime d’un grave accident il y a une dizaine d’années, Nagisa Oshima ne réalisera sans doute plus jamais de film. Pourtant, cette programmation établie par Alain Jalladeau ne se veut ni exhumation ni sanctification, mais retour sur un cinéaste essentiel, dont l’œuvre est cruciale pour le cinéma japonais et mondial. Il convient dès lors de profiter du Festival des 3 Continents pour découvrir (certains films sont inédits à Nantes) et redécouvrir une cinématographie d’une audace rare, pour en distinguer les conteurs malgré son extrême richesse, pour en envisager les éventuelles résonances dans le cinéma actuel. Et pour confronter, surtout, son propre désir à celui que Nagisa Oshima n’a eu de cesse de questionner.
Nicolas Thévenin