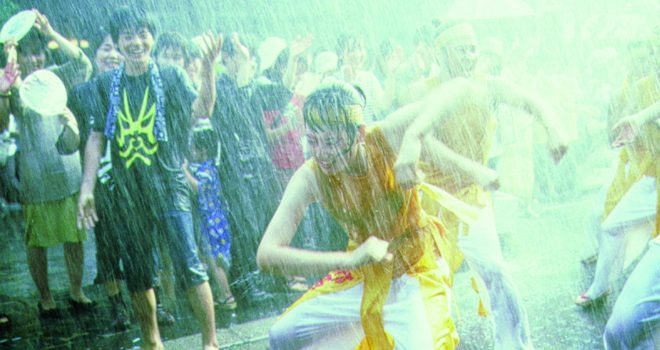Les manifestations de ce qui relève du fantastique au cinéma paraissent aisément identifiables. Chacun parvient à les discerner dans le genre et les sous-genres puisqu’elles sont exposées sur un mode déclaratif (souvent dès l’affiche du film) et des formules qui semblent indéfiniment extensibles : films de science-fiction que l’on peut étendre à un corollaire merveilleux ou légendaire dont les versions actuelles seraient super-héroïques ou fantaisies héroïques, films d’horreur jusqu’au gore, de fantômes ou de réincarnation, de monstres petits et grands aux desseins apocalyptiques… Puisant une part importante de son inspiration dans la relecture de motifs irriguant la peinture ou plus essentiellement forgés par la littérature de la toute fin du XVIIIe aux origines du XXe siècle, des frères Grimm à Andersen, d’Edgar Allan Poe à Jules Verne et Oscar Wilde, du romantisme allemand au roman gothique anglais (la naissance de Dracula sous la plume de Bram Stoker en 1897 est contemporaine de l’avènement du cinématographe des frères Lumière mais aussi de la psychanalyse freudienne), le cinéma fantastique est devenu un profitable repaire de savants fous, de génies du mal, de créatures monstrueuses, d’infirmes, d’animaux géants ou mythologiques, d’humains déchus et de zombies… Ce délirant cortège cinématographique d’anormalités, de dystopies et de déséquilibres inexplicables du réel est devenu un objet de fascination populaire. S’il doit fondamentalement son succès à la surenchère spectaculaire et technologique dont il a régulièrement fait l’objet, le cinéma fantastique compte parmi les genres les moins nobles au regard de la situation de la comédie (aujourd’hui en berne), du mélodrame ou du western (eux éteints). Il demeure néanmoins essentiel de souligner l’inépuisable réserve de sens et d’imaginaire appropriable qu’il a constitué pour des cinéastes aux intentions cinématographiques les plus variées de Georges Méliès à Victor Sjöstrom et Maurice Stiller, de Friedrich Wilhelm Murnau à Fritz Lang et Carl Theodor Dreyer, de James Whale à Jacques Tourneur et Alfred Hitchcock, de Louis Feuillade à Jean Epstein, Jean Cocteau ou Georges Franju, de Riccardo Freda à Mario Bava et Terence Fisher, de Georges Romero à Roger Corman et John Carpenter, aux deux David, Cronenberg et Lynch, jusqu’à Kiyoshi Kurosawa, etc… À la lecture de cette pléiade non-exhaustive et disparate de réalisateurs nous serions même tenter de jeter les bases d’une relecture de l’histoire du cinéma saisie par le prisme du fantastique. En posant les jalons d’une généalogie visant le genre comme un laboratoire, elle aurait pour première vertu de nous aider à déconstruire la bienpensante hiérarchie entre mode majeur et mineur, ou encore de renvoyer l’une à l’autre dimension spectaculaire et inspiration poétique.
Autrement dit, cette liste soutient une évidence : il nous faut prendre le fantastique au sérieux, tenir pour certitude que sa fortune trouve à s’imposer dans l’hétérogénéité de ce qu’il désigne, ou encore, qu’il se distingue de n’être imputable à aucun bon goût ou critère trop personnel, son objet étant l’exploration et l’expression des limites, d’un seuil infranchissable, d’une aberration. De cette manière, il ouvre un champ fécond pour la pensée, s’extirpant du carcan auquel le genre semble a priori le condamner : l’effet et l’anecdote. Car il découle de cette énumération une portée plus signifiante encore au sens où il y aurait à y déceler plutôt qu’un genre «un fantastique cinématographique » selon la formule appropriée de Jean-Louis Leutrat, et Antonin Artaud d’en préciser l’essence : «le cinéma n’est jamais autant lui-même que lorsqu’il frôle ce terrain vague, cette étroite lisière peuplée de créatures portant en elle la (cette) contradiction» du mort-vivant. Le cinéma nous plonge dans le noir. Soudain, une irréalité lumineuse surgit pour en découdre avec la nuit dans la salle où nous avons pris place. Une image sans épaisseur, translucide, depuis peu dématérialisée, donne vie à des spectres qui nous ressemblent au point que nous les sachions porteurs d’une vérité sur ceux que nous sommes. Ils portent le sceau de nos inquiétudes, devinent nos peurs, notre nostalgie des choses disparues, notre désir enfoui de les voir réapparaître, d’être ailleurs que dans notre vie, de croire à l’impossible. Ils savent que le cinéma s’apparente à quelques rites anciens comme celui des vieilles histoires tirées des feux de la nuit. L’intervention fantastique s’oppose à l’ordre naturel des choses et des événements. Elle nous tient dans le silence pendant que le film nous conduit vers un secret bien gardé que nous aurons naïvement le sentiment de construire (de découvrir) à travers lui. Éludant le régime ordinaire de causalité, le fantastique dévoile (sans forcément l’imager) ce que nous ne parvenons pas à penser, surprenant ainsi la fragilité des certitudes qui façonnent nos désirs et nos consciences, notre attachement sans secours à l’excès de rationalité qui règle notre monde. Et puisque le film nous fait prendre l’image pour le réel, le fictif pour le possible, il en use comme d’un maléfice pour nous faire passer de l’autre côté des apparences.
Ce programme de huit films (I Am Not a Witch est aussi proposé au public scolaire) est tout entier orienté par l’intention d’investir par les films différents états du fantastique. Et plutôt que de systématiquement pousser au rapprochement entre les œuvres, ce sont les invitations que dessinent leur juxtaposition qui ont orienté nos choix. Une manière d’affirmer qu’il y a des natures du fantastique et que chacune constitue, pour reprendre un autre bon mot d’Antonin Artaud, « un effort vers le cinéma véritable ».
Jérôme Baron